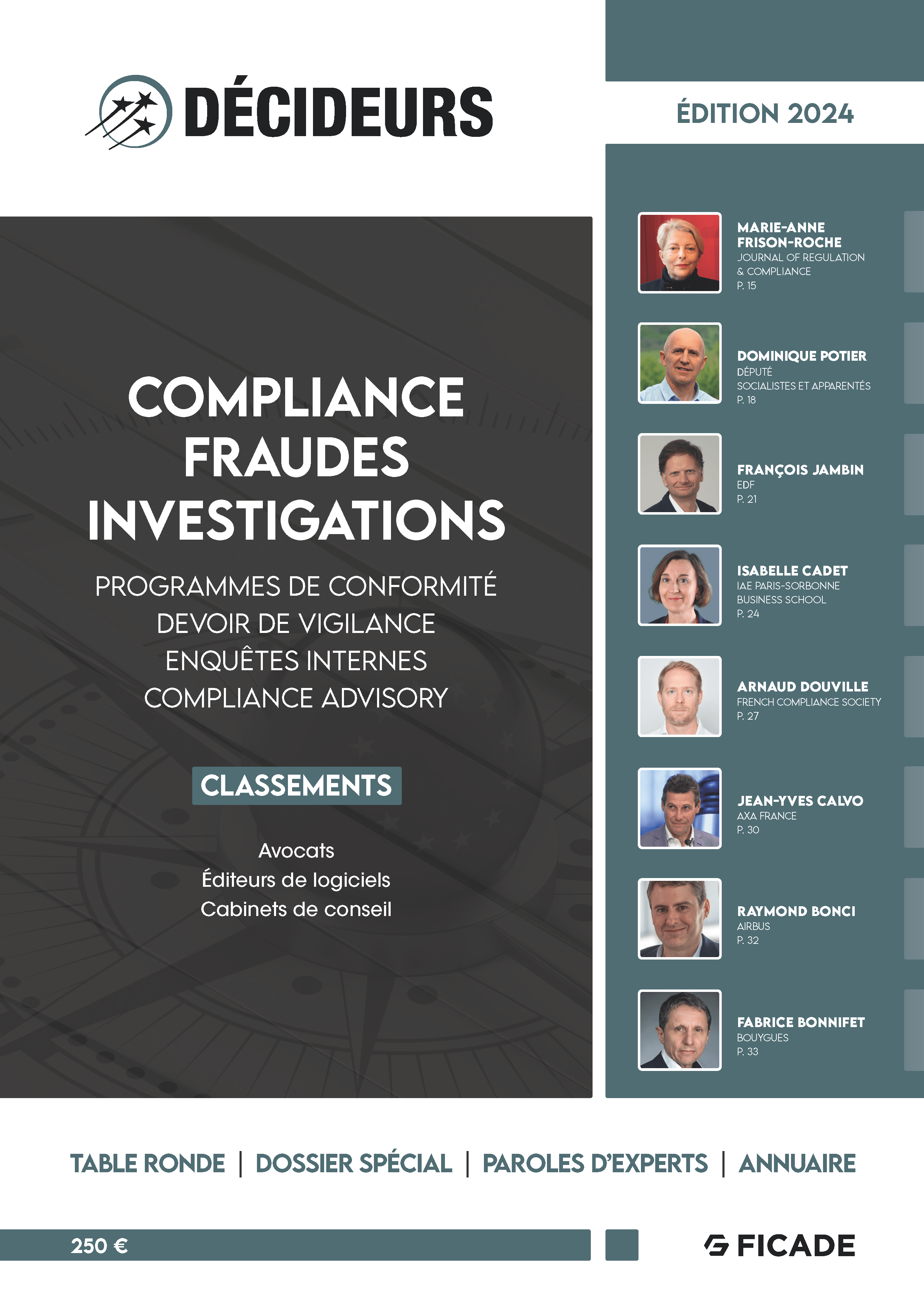Le pouvoir des ONG dans la mise en cause de la responsabilité pénale des entreprises
- Christophe Ingrain, Associé, Darrois Villey Maillot Brochier
- Rémi Lorrain, Counsel, Darrois Villey Maillot Brochier
- Lydia Meziani, Directrice juridique, Nestlé
- Laura Monnier, General Counsel, Greenpeace France
Décideurs. Quelle est l’origine des actions en justice des ONG et associations ?
Rémi Lorrain. Dès 1972, le législateur est intervenu pour autoriser de multiples associations à agir et/ou à intervenir devant le juge pénal. La jurisprudence de la chambre criminelle leur était alors très favorable, jusqu’à 2016, ayant une interprétation extensive, voire laxiste, de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Elle a ainsi contribué à la recevabilité des actions de ces associations, qui ne se sont pas privées pour saisir parquets et juges d’instruction contre les entreprises et dirigeants.
Est-ce que cette jurisprudence a évolué depuis ?
Rémi Lorrain. En 2017, cette même chambre criminelle a commencé à changer sa position et a évincé ces associations lorsqu’elles se constituaient en dehors de leur habilitation, par exemple dans le dossier Bygmalion dans lequel Anticor a été déclarée irrecevable. La chambre criminelle a donc désormais une interprétation un peu plus restrictive. Évidemment, beaucoup de critiques se sont élevées, et s’élèvent encore, à l’encontre de ces associations, qualifiées parfois d’ "accusateurs privés", de "pseudo-procureurs", de "procureurs bis", de "moralistes", etc. La difficulté avec certaines de ces associations étant que l’intérêt collectif – qu’elles prétendent défendre – se distingue parfois mal de l’intérêt général.
Christophe Ingrain. Cela entraîne, au cours de certaines audiences, une sur-représentation de ces associations et ONG dans des domaines très différents. Elles participent à construire l’image injuste et injustifiée d’un Parquet dépassé ou, pire, dépendant du pouvoir politique qui ne voudrait pas agir contre certaines entreprises ou certains dirigeants pour une raison inavouable.
Laura Monnier, êtes-vous d’accord avec cette image que beaucoup peuvent avoir des ONG ?
Laura Monnier. Les ONG ne sont pas des procureurs privés et nous n’avons pas envie d’être perçus comme tels. L’action publique est indépendante de l’action des associations, sinon cela ouvrirait la porte à un arbitraire. Il n’y pas de confusion entre les ONG et l’intérêt général auquel notre objet social contribue... Ce peut être l’environnement ou encore les droits de l’homme. Nous avons un rôle d’alerte dans les médias, mais le recours à la justice s’est effectivement démocratisé depuis une dizaine d’années alors qu’avant il était réservé à une élite. On remarque par exemple qu’il y a de plus en plus de contentieux climatiques et environnementaux parce que c’est un moyen pour la société civile de porter dans le débat démocratique des revendications légitimes. Nous allons néanmoins bien au-delà en demandant que ces droits fondamentaux soient respectés, comme le droit à un environnement sain. Les ONG s’emparent du droit pour essayer de remplir leur rôle d’alerte au niveau de l’intérêt général, en visant l’État et les entreprises. En revanche, nous n’avons pas vocation à remplacer un Parquet défaillant, d’autant plus qu’il garde le monopole des poursuites pour des infractions commises à l’étranger.
En pratique, nous intervenons dans des dossiers complexes, face à une justice qui peut être démunie sur certains sujets, tant d’un point de vue financier que sur les investigations de terrain. Il y a un manque de formation et de moyens de la justice. Les ONG ont donc un rôle indispensable : nous sommes comme des assistants de justice. Nous faisons des investigations et menons notre pré-enquête pour que le dossier soit le plus solide possible pour essayer de donner un maximum d’éléments au procureur et aux enquêteurs lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte.
"Les ONG ne sont pas des procureurs privés et nous n’avons pas envie d’être perçus comme tels"
L. Monnier
Lydia Méziani. Nos positions ne sont finalement pas éloignées les unes des autres dès lors qu’on parle de désobéissance civile : les associations viennent pallier certaines carences du droit. Or, aujourd’hui, nous nous rendons compte que les droits humains comme les droits environnementaux sont intégrés dans le droit de la compliance. Ce droit en construction se nourrit de bonnes pratiques qui deviennent la norme, la soft law. Les entreprises sont créatrices de droit. Avec ce retour au droit fonction d’une part et l’émergence d’enjeux nouveaux, la jurisprudence a une place centrale dans l’interprétation de l’esprit des textes. Les magistrats, comme les avocats et les juristes en entreprise, apprennent en faisant ; ce qui pose la double question de la formation des magistrats et de l’effectivité du droit. C’est en ce sens que je trouve que le rôle des ONG est essentiel lorsqu’on ne dispose pas d’un arsenal législatif permettant de faire bouger les lignes. Ces associations sont un véritable générateur de l’action citoyenne.
En revanche, nous sommes aujourd’hui dans une ère du "y a qu’à-faut qu’on", où ceux qui disent sont déconnectés de la réalité du terrain et ceux qui doivent faire se trouvent bien démunis. Le temps du Droit n’est pas nécessairement celui de l’urgence de la situation que nous affrontons. Ainsi, en ces temps d’incertitude juridique, le doute ne profite plus à la défense mais à l’accusation car nombre de ces textes du droit de la compliance engagent la responsabilité pénale de nos dirigeants, créant une certaine obligation de résultat sans nous éclairer sur les moyens à mettre en œuvre. La conséquence est une certaine présomption de culpabilité, nous faisant "tirer à coups de canon sur des souris" pour paraphraser Sauvé. Pourtant, le principe de proportionnalité est un des piliers d’un État de droit…
Le temps pénal n’est pas celui du temps médiatique : c’est un temps très long qui profite aux coupables. Une entreprise attaquée sur ces sujets cruciaux est déjà reconnue coupable par l’opinion publique : "Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose", disait Talleyrand.
Laura Monnier. Comme nous sommes sur des sujets d’intérêt général, nos communications contribuent au débat démocratique, surtout sur des thématiques sur lesquelles le droit est d’une lenteur extrême. Aujourd’hui, les entreprises n’ont aucune obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par exemple. II y a certes un devoir de vigilance, fruit d’une bataille législative importante, qui présente des avantages. Mais l’arsenal juridique reste faible. Il est très difficile de faire avancer le droit sur ces sujets-là car on fait face à des lobbies et des intérêts économiques et politiques puissants. C’est en activant des actions juridiques, de communication et de mobilisation sur un même sujet qu’on espère faire progresser la justice.
Lydia Méziani. De toute façon, la finalité n’est pas que la promotion législative des droits humains, autrement nous nous heurtons rapidement aux lois de blocage et à la souveraineté nationale. De plus, cela laisse à penser qu’en l’absence de cadre législatif, les entreprises peuvent s’abstenir de faire la bonne chose pour la bonne raison. Ce qui est le propre de la compliance. Les entreprises qui n’agissent que par obligation sont les mêmes que celles qui feront de l’optimisation fiscale et n’intègrent pas dans leur vision long terme le concept de création de valeur partagée. La raison d’être d’une entreprise est de créer de la valeur. La condition sine qua non de sa durabilité est de la partager.
Aujourd’hui, il y a urgence à agir. Cessons d’opposer le privé et le public, le politique et l’entreprise. La question à laquelle nous devons tous ensemble répondre est quelle communauté d’espoir voulons-nous ?
Au politique de fixer la feuille de route. Au législateur de fixer le cadre. Aux acteurs privés et publics d’agir en conséquence.
Qu’en pensez-vous messieurs avec votre regard d’avocats ?
Christophe Ingrain. Si un procureur décide de ne pas poursuivre ou de ne pas ouvrir une enquête, cela ne veut pas dire qu’il y a une carence. Il peut avoir considéré que les faits ne caractérisent pas une infraction, ou que l’infraction ne mérite pas d’être poursuivie : cela s’appelle l’opportunité des poursuites et la justification de ce principe réside dans la qualité de "magistrat" du procureur de la République.
Les ONG produisent des enquêtes préalables et des dossiers bien montés. Mais l’entreprise visée peut elle aussi à son tour diligenter une enquête en réponse pour démontrer que les accusations ne sont pas exactes.
Grâce ou à cause des ONG, nous faisons entrer dans notre système judiciaire un schéma dans lequel l’autorité judiciaire ne procède plus à des investigations mais vérifie et arbitre.
"Grâce ou à cause des ONG, nous faisons entrer dans notre système judiciaire un schéma dans lequel l’autorité judiciaire ne procède plus à des investigations mais vérifie et arbitre"
C. Ingrain
Rémi Lorrain. Il y a une certaine privatisation de la chaîne pénale. En pratique, lorsque des entreprises mènent des enquêtes internes et des associations des enquêtes préalables, ces documents sont complètement soustraits aux garanties de la procédure pénale. On ne peut pas agir en nullité contre les pièces fournies par des ONG. Il n’y a pas de principe de loyauté de la preuve quand elle est administrée par une partie civile au pénal, contrairement à la procédure commerciale ou civile. Cela pose donc des difficultés pour la défense. On se rend compte que les garanties procédurales deviennent quasiment subsidiaires à l’administration de la preuve.
Lydia Méziani. Les enquêtes internes ne sont pas suffisamment encadrées, et c’est là le problème. Une certitude sur une alerte pour soupçons de corruption, de harcèlement sexuel ou de discrimination : la responsabilité du dirigeant va être nécessairement engagée.
En revanche, comment devons-nous les réaliser ? Comment concilier certaines libertés fondamentales que les textes opposent ? Là encore, c’est la responsabilité des entreprises…
Aujourd’hui, le droit est devenu un vrai facteur d’incertitude. Comme nous ne définissons plus les mots et que nous n’avons pas de référentiel, nous n’avons pas d’action collective. L’entreprise est à la fois créatrice de droit mais bien seule à l’heure de faire le bilan…
Qu’en est-il de la responsabilité des acteurs publics et privés en matière de protection de l’environnement ?
Laura Monnier. Récemment, "l’affaire du siècle" a reconnu la faute de l’État pour son inaction climatique. Chez Greenpeace, nous engageons des actions, souvent administratives mais parfois au pénal et au civil, contre les acteurs qui contribuent au réchauffement climatique. Nous nous attachons avec un soin tout particulier à mener des enquêtes de terrain. Sur tous ces sujets de criminalité environnementale, nous essayons d’objectiver au maximum nos preuves et de constituer un dossier solide. Dans certains secteurs, les entreprises sont censées être contrôlées par l’administration. Mais ces services manquent de moyens et de formation ainsi que d’indépendance. Pour vérifier qu’une entreprise fait suffisamment de diligence raisonnée, c’est assez complexe, car ce sont des sujets très techniques et l’administration est assez défaillante là-dessus. Elle joue un rôle qui n’est pas le bon car elle donne un blanc-seing à l’entreprise en disant qu’elle est conforme sur la base de certifications et non d’une enquête sur place, ce qui a tendance à biaiser et donc affaiblir l’action publique.
Lydia Méziani. Je suis d’accord avec Laura. Mais l’industriel est là pour faire des produits. À titre d’exemple, ma collègue des affaires réglementaires doit veiller à la conformité réglementaire de 137 textes pour nos produits… dont certains sont pour le moins abscons. La compliance repose sur deux fondements : la transparence et la traçabilité. Ne pourrions-nous pas avoir une base de données référençant les fournisseurs sur la base des critères droits humains et droits environnementaux ? Adoptons une méthodologie commune qui intègre le respect des droits humains et environnementaux et surtout les plans de remédiation et partageons. Cela évitera de critiquer a posteriori et sera plus constructif. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de bien faire les choses.
Laura Monnier. Ce n’est pas à nous de faire ce référentiel. Les audits des entreprises se font sur documents ou certificats et non sur le terrain. Certaines sociétés mettent en avant cette défense-là, ce qui pose un réel problème. Les ONG d’investigation vont sur le terrain, mais ce sont aux entreprises d’établir un référentiel, en faisant elles-mêmes leurs enquêtes.
Christophe Ingrain. Pour ce qui est de l’objectif de la protection des droits humains, je ne sais pas si la réponse pénale et ses conséquences, la mise en examen d’un dirigeant ou d’une société et donc, à plus ou moins court terme, le départ d’une société d’un pays, sont de nature à améliorer la situation des droits humains dans ce pays. Je vois bien l’intérêt du pénal pour les ONG, parce que le pénal se prête à la médiatisation, qu’il y a en France une tradition de recherche de culpabilité et d’exemplarité de la peine, mais je ne suis pas certain que cela soit la solution.
Qu’attendez-vous de la mise en cause pénale ?
Laura Monnier. Dès lors qu’un délit a été commis, il est logique qu’il y ait une condamnation. Évidemment, cela ne réglera pas la souffrance des victimes en matière de terrorisme par exemple, il ne faut pas qu’il y ait des attentes démesurées par rapport à cela. Que la justice prenne un rôle efficace en matière d’environnement, cela a tout son sens. C’est ce qu’on attend d’un État de droit. Et la justice devrait s’approprier encore davantage cette thématique. Mais cela ne réglera pas le problème. La condamnation de l’État pour son inaction climatique en est un exemple. Le temps de la justice n’est de toute façon pas approprié à l’urgence climatique. Nous sommes dans un État de droit, et ne pas activer la justice quand des délits sont commis puis crier à l’injustice, c’est totalement contradictoire. Cela est donc notre devoir d’apporter ces dossiers devant la justice et que des enquêtes soient ouvertes.
"On a le sentiment qu’avec la CJIP, le procès est devenu une contrainte, et que le pénal des entreprises n’est plus qu’une histoire de coût"
R. Lorrain
Lydia Méziani. La question soulevée est également celle de la coopération internationale. Par exemple, en matière fiscale, le droit est utilisé dans la compétition que se livrent les États pour préserver les intérêts économiques de chaque pays. Les grandes entreprises veulent plus de droit et un référentiel plus clair, afin de préserver la compétitivité économique de nos entreprises en ayant les mêmes règles du jeu et être accompagnées dans ce passage de l’ex post à l’ex ante.
Christophe Ingrain. Il est certain que le législateur n’est pas courageux. Lorsqu’il est sollicité, le juge ne fait que suppléer aux silences du législateur et a recours à des interprétations souples de la loi pénale. Mais lorsqu’on multiplie toutes les interprétations souples d’une infraction pénale, sur la notion de complicité ou de blanchiment, on dénature quasiment tout, et le juge peut décider de faire entrer dans le champ pénal un comportement qui ne l’était pas aux termes d’une loi stricte et strictement interprétée. C’est donc de ces interprétations beaucoup trop souples que peut naître l’arbitraire du juge, ce qui fait naître un aléa considérable et donc un manque de prévisibilité pour les acteurs privés.
Lydia Méziani. Romain Gary écrivait : "De toute façon, tout le monde ment dès qu’il se met à parler au lieu de faire."
Rémi Lorrain. Exactement. Le PNF a un compte twitter, les procureurs font des conférences de presse…
Laura Monnier. En tant qu’ancienne avocate, je comprends très bien votre point. Mais nous sommes sur des sujets où on dépasse selon moi cette protection stricto sensu de la présomption d’innocence. Tout dépend de comment on communique. Les sujets environnementaux dépassent le cadre individuel. Par exemple, admettons que le dirigeant de Total soit mis en examen pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire Polytechnique : c’est un sujet d’intérêt général puisqu’il s’agit d’une société qui contribue au changement climatique. Nous faisons notre travail d’ONG en dénonçant ces pratiques. Évidemment, il ne faut pas communiquer n’importe comment et nous faisons une évaluation des risques juridiques de notre communication afin qu’elle soit le plus juste possible.
Lydia Méziani. Pourquoi ne pas interdire l’activité pétrolière à ce rythme ? Il y a aujourd’hui une certaine hypocrisie, tout comme sur les Gafam. D’un côté, l’évasion fiscale organisée par ses artisans de la fraude est dénoncée, d’un autre l’idée d’une collaboration sur des enjeux de sécurité est envisagée. Le droit de la compliance c’est du droit, ce qui est légal et ce qui est illégal mais c’est de plus en plus, à tort ou à raison, de la moralité. La question est donc : si les pouvoirs publics considèrent qu’une activité est immorale, doivent-ils pour autant la rendre illégale ?
Christophe Ingrain. Le droit pénal pour les ONG est à la fois un outil pour alerter et faire sanctionner. C’est également un moyen de faire avancer la législation, pour faire réagir. Mais ce n’est pas l’objectif du droit pénal de faire avancer le droit ou de renforcer la protection de tel ou tel principe. Il y a une différence entre la sanction d’un acte et la promotion de politiques publiques.
On parle de plus en plus de la pénalisation de la vie des affaires depuis quelques années. Quel regard portez-vous sur ce sujet ?
Rémi Lorrain. On constate un double mouvement. D’une part, la « responsabilité pénale du manquement » est de plus en plus fréquente, c’est-à-dire que les entreprises et dirigeants voient leur responsabilité pénale engagée du fait de la seule violation d’une obligation. Il s’agit d’une sorte de droit pénal de la compliance dans lequel c’est l’absence de procédure ou la défaillance de celle-ci qui est sanctionnée, peu importe qu’il n’y ait pas eu de préjudice ou de victime. D’autre part, on note également que la responsabilité pénale de la personne morale prenait autrefois sa source dans une faute individuelle (la faute du dirigeant ou du représentant), elle la prend désormais de plus en plus dans une faute organisationnelle (un dysfonctionnement de la structure). Désormais, nous sommes donc sur une responsabilité pénale pour manquement et organisationnelle, que les juges ne cherchent même plus à imputer à qui que ce soit au sein de l’entreprise mais l’imputent tout simplement au "management" : "organisation matricielle", "organisation transversale", "politique de groupe", etc., tels sont les mots employés pour imputer la commission d’une infraction. Nous sommes donc dans une responsabilité pénale complètement désincarnée.
Justement, que pensez-vous de la CJIP et de la justice négociée ?
Laura Monnier. Nous sommes totalement défavorables à la CJIP car elle ne répond pas aux attentes démocratiques aux sujets d’intérêt général. Il n’y a dans ce cas-là pas de débat contradictoire en audience, il n’y a pas de peine, pas de casier judiciaire… On a le sentiment qu’il s’agit d’une solution alternative à l’échec pénal. Ainsi, on tente de trouver une voie alternative alors qu’en réalité, il faudrait renforcer selon nous l’arsenal juridique actuel. Avec la CJIP, il n’y a pas de publicité des débats, ce qui est regrettable.
Christophe Ingrain. Il ne faut pas oublier que la CJIP est un fusil à un coup : une société a droit à une seule CJIP. Les entreprises paient très cher ce droit à l’erreur, beaucoup plus cher qu’une condamnation qui pourrait leur être imposée par une juridiction. Ce droit à l’erreur unique n’est pas scandaleux et je trouve que les ONG pourraient le reconnaître.
Rémi Lorrain. Je suis assez surpris de la position des ONG parce que la CJIP est encouragée par le législateur lui-même pour des infractions qui, bien que médiatisées, ont rarement donné lieu à une condamnation. C’est souvent dans des domaines où il existe des difficultés d’administration de la preuve, où on n’est pas parvenu à faire condamner des entreprises, comme dans le domaine de l’environnement. La CJIP a été étendue en 2020 à la fraude fiscale, car il est très difficile pour des questions techniques d’imputer du droit fiscal à une entreprise, ou encore la corruption avec des agents publics étrangers… La CJIP ne s’épanouit que dans un cadre où on n’a pas de condamnation de personnes morales. Elle vient donc couvrir un manque.
De plus, la CJIP est rendue publique automatiquement, même s’il n’y a pas d’audience classique publique. Cette convention s’intéresse moins aux faits passés qu’aux mesures futures prises par l’entreprise. Il y a donc un vrai aspect pédagogique.
"Le temps pénal n’est pas celui du temps médiatique. C’est un temps très long qui profite aux coupables. Une entreprise attaquée sur ces sujets cruciaux est déjà reconnue coupable par l’opinion publique"
L. Méziani
Mais il est vrai qu’on a le sentiment qu’avec la CJIP, le procès est devenu une contrainte, et que le pénal des entreprises n’est plus qu’une histoire de coût. On parle de plus en plus de budget, d’efficience ou d’efficacité de la procédure pénale mais de moins en moins de droit. Ce coût à payer pour l’entreprise justiciable pour éviter une condamnation pénale permet également aux juges de faire des économies de raisonnement considérables : je suis toujours étonné de comparer les CJIP (rédigées sur quelques pages) avec les décisions de justice rendues par les tribunaux et les cours d’appel en matière correctionnelle (plusieurs centaines de pages dans de nombreux procès de droit pénal des affaires). Ne pas mener jusqu’à son terme le processus probatoire peut constituer un certain danger : ne pas épuiser exhaustivement les faits puis le raisonnement peut constituer un risque eu égard au non bis in idem éventuel.
Lydia Méziani. Le droit à l’erreur, c’est ce qui rend la justice humaine aussi. Mais je peux comprendre certaines réactions qui consistent à dire qu’on se paye une bonne conscience en signant une CJIP. Le droit de la compliance est dans son ambition inspiré du droit fiscal (lutte contre…) et dans son application tiré du droit pénal (proportionnalité de la sanction, exemplarité, etc.).
Laura Monnier. Mais vous comprenez bien que dans le milieu militant et de la société civile, des militants ont des casiers judiciaires parce qu’ils ont fait un blocage d’un site industriel par exemple pour alerter l’opinion et les médias, alors que les entreprises, elles, n’ont pas de casier : ce n’est pas normal. Ce système de justice privée vers lequel on tend est une solution par défaut. Ainsi, la CJIP ne me paraît pas souhaitable pour toutes les questions liées à l’environnement. Lorsqu’on va en justice avec nos éléments de preuve, il y a quand même l’appréciation du juge. Ces dossiers sont encore récents devant les tribunaux et j’espère que la jurisprudence fournira une ligne directrice aux entreprises sur ces questions. Sur le devoir de vigilance, de nombreux guides sont déjà fournis par des associations.
Rémi Lorrain. Il y a quelques mois, on a appris que certaines ONG lisaient très attentivement les CJIP pour ensuite poursuivre les dirigeants d’entreprise. On parlait plus tôt de l’incertitude de la norme. Désormais, il y a une incertitude même sur ces procédures alternatives à cause de précédents, comme l’affaire Bolloré.
Lydia Méziani. Le fait que les militants aient un casier judiciaire et pas les entreprises interpelle. Mais nous sommes dans un État de Droit. Sur les droits environnementaux, on ne peut que souscrire à votre propos, mais sur le reste, un peu moins.
Qu’en est-il de la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants en zone de conflit ?
Christophe Ingrain. Les décisions rendues depuis quelques années à l’encontre des personnes morales disposant de filiales à l’étranger ont pour conséquence d’encourager au départ du pays dès qu’un conflit y éclate car les risques sont énormes pour elles : la morale transforme le droit pénal, en fait son outil. C’est particulièrement le cas lorsqu’ une entreprise française est concernée par des faits intervenus en zone de conflit. Tout acte moralement répréhensible commis en situation de conflit est susceptible de fonder la responsabilité pénale de la société française, y compris la mère, et/ou de son dirigeant français. La gravité générale de la situation rend la règle pénale plus souple encore.
Rémi Lorrain. Actuellement, à en croire les articles de presse, il doit y avoir près d’une dizaine d’entreprises qui sont potentiellement inquiétées pour complicité de crime de guerre/crime contre l’humanité. Ce qui est à craindre, c’est une sorte de criminalisation de faits correctionnels, uniquement à des fins de poursuites (prescription, coercition, etc.).
Lydia Méziani. Mais vivre c’est risquer. Et à un moment, il faut aussi faire quelque chose. Une entreprise éthique assumera le fait d’être resté dans un pays en conflit, tel que l’Iran, la Syrie ou encore l’Algérie. Par exemple, Nestlé a toujours maintenu sa présence dans les pays à risque même en période de conflit. Nous produisons localement dans la majorité des pays où nous sommes présents. Vous ne pouvez pas dire quand tout va bien et que l’entreprise fait partie de la communauté locale, contribue à un vivre ensemble, et quitter le pays dès qu’il y a des tensions. Les consommateurs se souviendront de ceux qui sont restés.
Laura Monnier. Ces questions-là vont se multiplier avec l’augmentation du nombre de conflits en raison du changement climatique qui impacte les ressources et donc la sécurité des personnes, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.
Propos recueillis par Margaux Savarit-Cornali
Christophe Ingrain et Rémi Lorrain (Darrois Villey Maillot Brochier)
Lydia Meziani (Nestlé) et Laura Monnier (Greenpeace France)