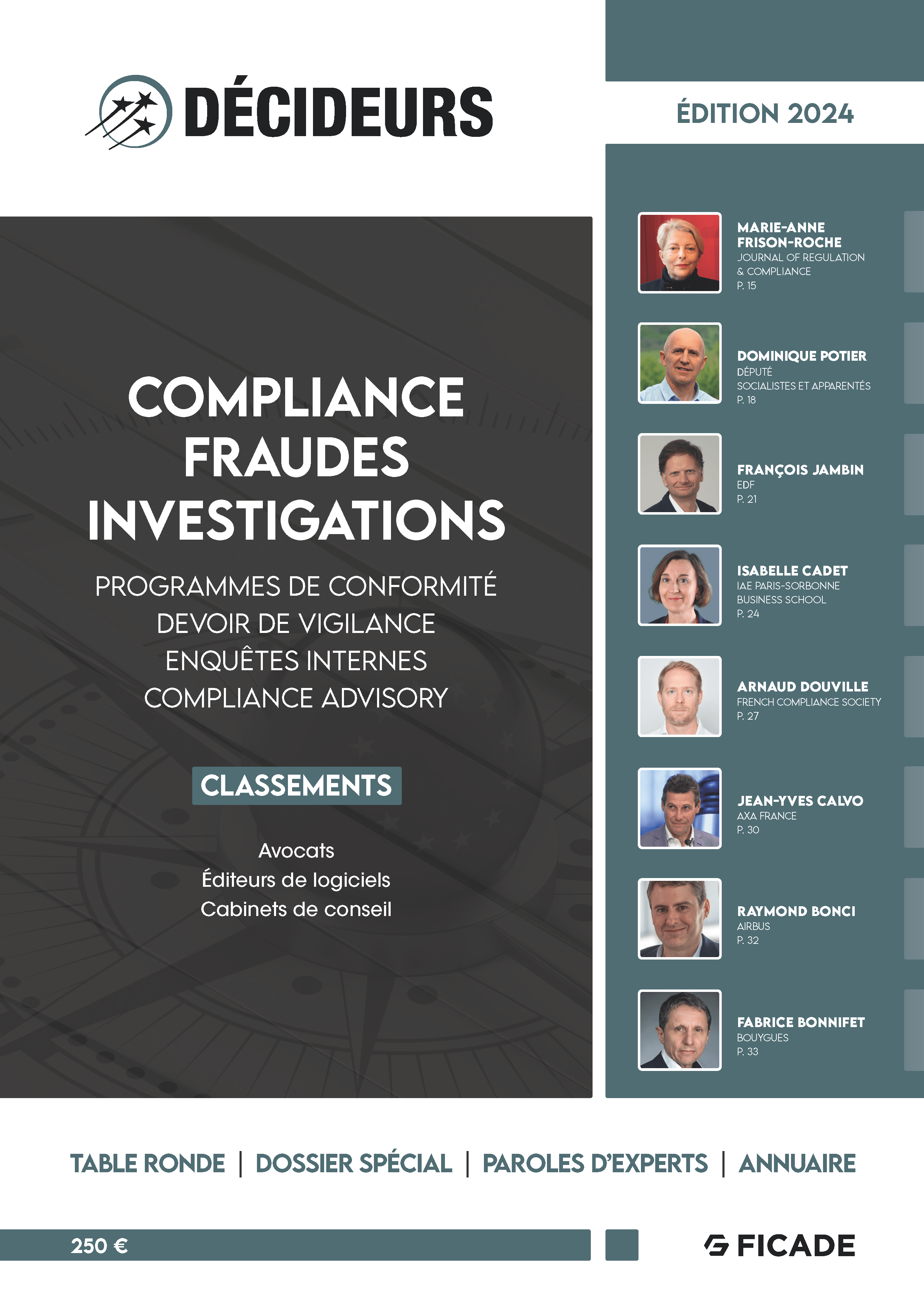Par Anne Murgier, avocat of counsel, Capstan Avocats
Le glissement du co-emploi vers la responsabilité civile délictuelle
Le co-emploi agite les prétoires depuis maintenant une dizaine d’années. La jurisprudence sociale s’est éloignée d’une approche traditionnelle, qui impliquait l’exigence d’un lien de subordination juridique, pour concevoir une formule du co-emploi reposant sur le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités, de direction entre plusieurs sociétés.
Par ce biais, les juges ont ouvert la brèche d’un abondant contentieux. De nombreux praticiens n’ont, en effet, pas hésité à solliciter cette nouvelle formule, aux contours relativement flous, pour trouver un second débiteur des obligations sociales, au sein des groupes de sociétés, au profit d’une collectivité de salariés.
La société, reconnue co-employeur, prise en défaut de ne pas avoir respecté des obligations qui de son point de vue ne lui étaient pas applicables, est condamnée de façon quasi systématique sans avoir pu en mesurer le danger.
L’objectif poursuivi était ainsi de fournir aux salariés licenciés un débiteur solvable pour réparer le préjudice lié à la rupture de leur contrat de travail, enjeu dont on comprend bien l’intérêt, en cas de défaillance de l’employeur « affiché ».
La Cour de cassation vient de mettre un coup d’arrêt à cette perspective.
Dans un arrêt Molex du 2 juillet 2014, elle juge qu’ « une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière » (Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°13-15208).
Cette clarification était attendue. Dès novembre 2013, Pierre Bailly, conseiller à la Cour de cassation précisait que le co-emploi « ne résulte pas de la seule appartenance à un même groupe et des solidarités qu’elle crée », il suppose «une situation anormale faisant disparaître l’autonomie de l’employeur soumis à l’ingérence d’un tiers » et doit rester cantonné à une situation tout à fait exceptionnelle (Pierre Bailly, Le co-emploi, une situation tout à fait exceptionnelle, JCP S, 12 novembre 2013, n°1441).
En cette matière, le juge devra désormais s’attacher à distinguer la gestion normale d’un groupe de sociétés, qui implique une politique économique commune, d’une immixtion jugée anormale, abusive, de la société mère dans la gestion économique et sociale de l’entité dominée.
Le co-emploi devrait désormais être cantonné à la situation d’une entité réduite au rang de société de façade, dirigée tant sur le plan économique que social par la société qui la contrôle et dans son propre intérêt.
Si cet arrêt marque un net recul de cette approche du co-emploi, elle n’est pas abandonnée pour autant. L’affaire dite des « Conti de Clairoix » s’en est encore fait l’écho dernièrement (CA Amiens, 5e ch. soc., cabinet A, Continental France SNC et a. c. divers salariés, n°13/05612).
La prudence reste donc de mise. La société dominante doit se montrer vigilante à ne pas s’immiscer dans la gestion directe de la société dominée, à ne pas intervenir dans sa gestion interne, opérationnelle et sociale.
Si la société ne décide pas elle-même de son avenir, de sa stratégie ou de sa clientèle, ou encore si elle ne gère pas elle-même ses ressources humaines et les relations avec ses partenaires sociaux, les juges auront tendance à considérer que l’actionnaire est coupable d’une immixtion anormale et pourront, en l’état du droit, continuer de sanctionner cette pratique par le co-emploi.
Cette clarification des critères du co-emploi doit être approuvée. L’approche extensive du co-emploi était une source d’insécurité juridique et constituait un frein à la solidarité et à la coordination entre les entités juridiques d’un même groupe. Or celles-ci n’ont jamais été autant nécessaires.
Mais ce déclin annoncé du co-emploi pourrait s’accompagner d’un retour à une notion autrement plus classique, la responsabilité civile délictuelle.
Par deux arrêts en date du 8 juillet 2014 (Cass. Soc. 8 juillet 2014, n°13-15573 ; Cass. Soc. 8 juillet 2014, n°13-15470), la Cour de cassation, quelques jours après le coup d’arrêt donné au co-emploi, reconnait la responsabilité d’une société mère qui avait concouru « par sa faute et sa légèreté blâmable à la déconfiture de la filiale employeur ».
La Cour de cassation sanctionne ainsi la société mère qui prend des « décisions dommageables pour [sa fille], qui aggrav[ent] la situation économique difficile de celle-ci, ne répond[ent] à aucune utilité pour elle et ne [sont] profitables qu’à son actionnaire unique ».
Si ces décisions concourent à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois, la société mère encourt une condamnation à verser des dommages et intérêts aux salariés en raison du préjudice qu’elle a causé. Plus modestement qu’en matière de co-emploi, le préjudice réparable devrait consister alors en la perte d’une chance d’avoir pu conserver son emploi.
L’existence de cette action en responsabilité délictuelle, appliquée au droit du licenciement économique, n’est pas nouvelle (V. not. Cass. Soc. 14 novembre 2007, n°05-21239), mais cette alternative était occultée par le co-emploi qui cristallisait l’attention des praticiens et des magistrats.
Forts de ces récentes mises au point, les praticiens vont certainement rectifier leur argumentaire et emprunter désormais la voie de la responsabilité délictuelle, en lieu et place du co-emploi. Les demandeurs devront pouvoir faire la démonstration d’un comportement fautif dont les juges devront affiner les contours. Surtout, il ne faudra pas oublier que cette action devra s’articuler avec d’autres notions retenues dans d’autres branches du droit, notamment par le droit des sociétés. Affaire à suivre...
Par ce biais, les juges ont ouvert la brèche d’un abondant contentieux. De nombreux praticiens n’ont, en effet, pas hésité à solliciter cette nouvelle formule, aux contours relativement flous, pour trouver un second débiteur des obligations sociales, au sein des groupes de sociétés, au profit d’une collectivité de salariés.
La société, reconnue co-employeur, prise en défaut de ne pas avoir respecté des obligations qui de son point de vue ne lui étaient pas applicables, est condamnée de façon quasi systématique sans avoir pu en mesurer le danger.
L’objectif poursuivi était ainsi de fournir aux salariés licenciés un débiteur solvable pour réparer le préjudice lié à la rupture de leur contrat de travail, enjeu dont on comprend bien l’intérêt, en cas de défaillance de l’employeur « affiché ».
La Cour de cassation vient de mettre un coup d’arrêt à cette perspective.
Dans un arrêt Molex du 2 juillet 2014, elle juge qu’ « une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière » (Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°13-15208).
Cette clarification était attendue. Dès novembre 2013, Pierre Bailly, conseiller à la Cour de cassation précisait que le co-emploi « ne résulte pas de la seule appartenance à un même groupe et des solidarités qu’elle crée », il suppose «une situation anormale faisant disparaître l’autonomie de l’employeur soumis à l’ingérence d’un tiers » et doit rester cantonné à une situation tout à fait exceptionnelle (Pierre Bailly, Le co-emploi, une situation tout à fait exceptionnelle, JCP S, 12 novembre 2013, n°1441).
En cette matière, le juge devra désormais s’attacher à distinguer la gestion normale d’un groupe de sociétés, qui implique une politique économique commune, d’une immixtion jugée anormale, abusive, de la société mère dans la gestion économique et sociale de l’entité dominée.
Le co-emploi devrait désormais être cantonné à la situation d’une entité réduite au rang de société de façade, dirigée tant sur le plan économique que social par la société qui la contrôle et dans son propre intérêt.
Si cet arrêt marque un net recul de cette approche du co-emploi, elle n’est pas abandonnée pour autant. L’affaire dite des « Conti de Clairoix » s’en est encore fait l’écho dernièrement (CA Amiens, 5e ch. soc., cabinet A, Continental France SNC et a. c. divers salariés, n°13/05612).
La prudence reste donc de mise. La société dominante doit se montrer vigilante à ne pas s’immiscer dans la gestion directe de la société dominée, à ne pas intervenir dans sa gestion interne, opérationnelle et sociale.
Si la société ne décide pas elle-même de son avenir, de sa stratégie ou de sa clientèle, ou encore si elle ne gère pas elle-même ses ressources humaines et les relations avec ses partenaires sociaux, les juges auront tendance à considérer que l’actionnaire est coupable d’une immixtion anormale et pourront, en l’état du droit, continuer de sanctionner cette pratique par le co-emploi.
Cette clarification des critères du co-emploi doit être approuvée. L’approche extensive du co-emploi était une source d’insécurité juridique et constituait un frein à la solidarité et à la coordination entre les entités juridiques d’un même groupe. Or celles-ci n’ont jamais été autant nécessaires.
Mais ce déclin annoncé du co-emploi pourrait s’accompagner d’un retour à une notion autrement plus classique, la responsabilité civile délictuelle.
Par deux arrêts en date du 8 juillet 2014 (Cass. Soc. 8 juillet 2014, n°13-15573 ; Cass. Soc. 8 juillet 2014, n°13-15470), la Cour de cassation, quelques jours après le coup d’arrêt donné au co-emploi, reconnait la responsabilité d’une société mère qui avait concouru « par sa faute et sa légèreté blâmable à la déconfiture de la filiale employeur ».
La Cour de cassation sanctionne ainsi la société mère qui prend des « décisions dommageables pour [sa fille], qui aggrav[ent] la situation économique difficile de celle-ci, ne répond[ent] à aucune utilité pour elle et ne [sont] profitables qu’à son actionnaire unique ».
Si ces décisions concourent à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois, la société mère encourt une condamnation à verser des dommages et intérêts aux salariés en raison du préjudice qu’elle a causé. Plus modestement qu’en matière de co-emploi, le préjudice réparable devrait consister alors en la perte d’une chance d’avoir pu conserver son emploi.
L’existence de cette action en responsabilité délictuelle, appliquée au droit du licenciement économique, n’est pas nouvelle (V. not. Cass. Soc. 14 novembre 2007, n°05-21239), mais cette alternative était occultée par le co-emploi qui cristallisait l’attention des praticiens et des magistrats.
Forts de ces récentes mises au point, les praticiens vont certainement rectifier leur argumentaire et emprunter désormais la voie de la responsabilité délictuelle, en lieu et place du co-emploi. Les demandeurs devront pouvoir faire la démonstration d’un comportement fautif dont les juges devront affiner les contours. Surtout, il ne faudra pas oublier que cette action devra s’articuler avec d’autres notions retenues dans d’autres branches du droit, notamment par le droit des sociétés. Affaire à suivre...